Retrouvrez toute l’actualité du Groupe.

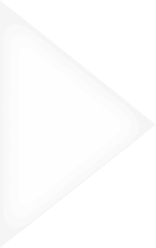
Ancré depuis plus de 150 ans à Cognac près de Cherves- Richemont, le Groupe Garandeau tient une place importante dans l’économie charentaise. Aujourd’hui fort de plus de 680 salariés, le groupe est également présent en Charente Maritime, Vienne, Haute Vienne, Gironde et Dordogne.
Fournisseur de premier plan du BTP régional, nous développons nos activités dans la production de granulats naturels et recyclés, la préfabrication béton, le béton prêt à l’emploi et les magasins de matériaux de construction.
rejoindre le
groupe garandeau
rejoindre le
groupe garandeau
L’histoire de Garandeau, c’est avant tout celle d’hommes et de femmes engagés qui ont mis et qui mettent leur énergie, leur courage et leur passion au service d’un objectif commun : produire et livrer des matériaux de qualité pour répondre aux besoins de nos clients. C’est cette culture commune de savoir-faire partagé, d’esprit d’équipe, d’engagement et d’innovation que nous avons voulu célébrer avec notre film institutionnel et avec la soirée des 150 ans. Notre attachement à cette humanité et à ces valeurs doit irriguer nos décisions et nos projets.
Tanguy Chauvière Le Drian, Directeur Général
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |